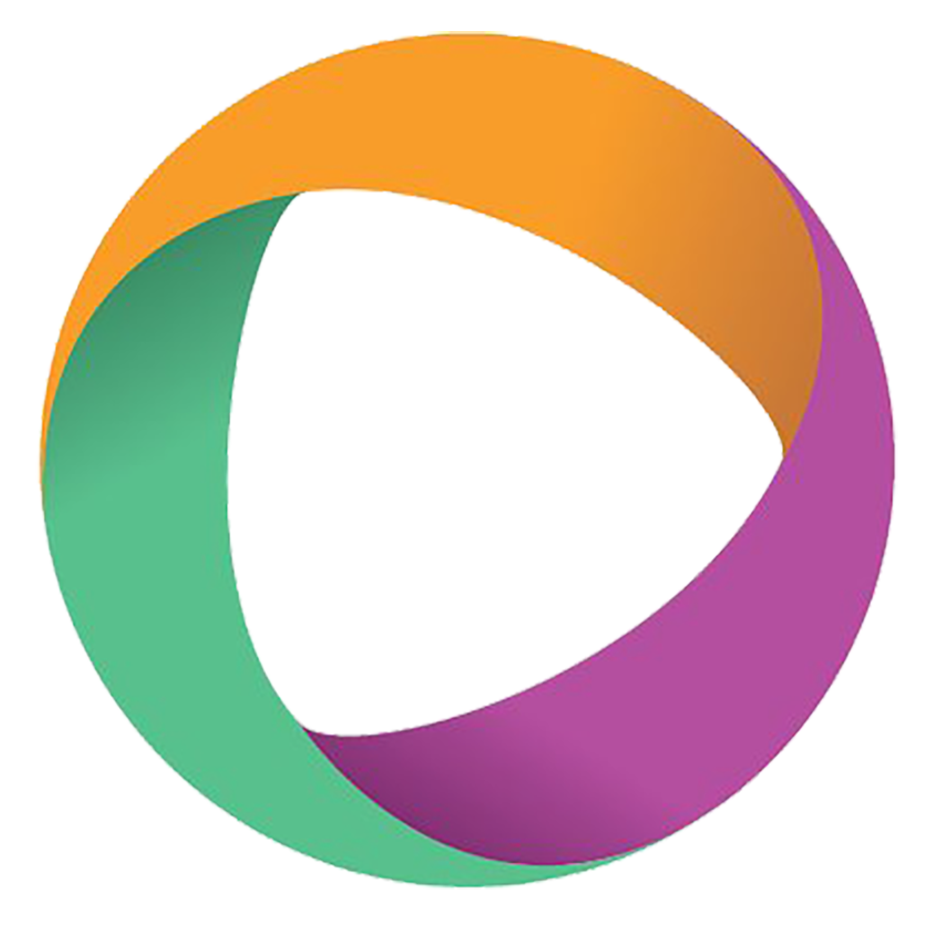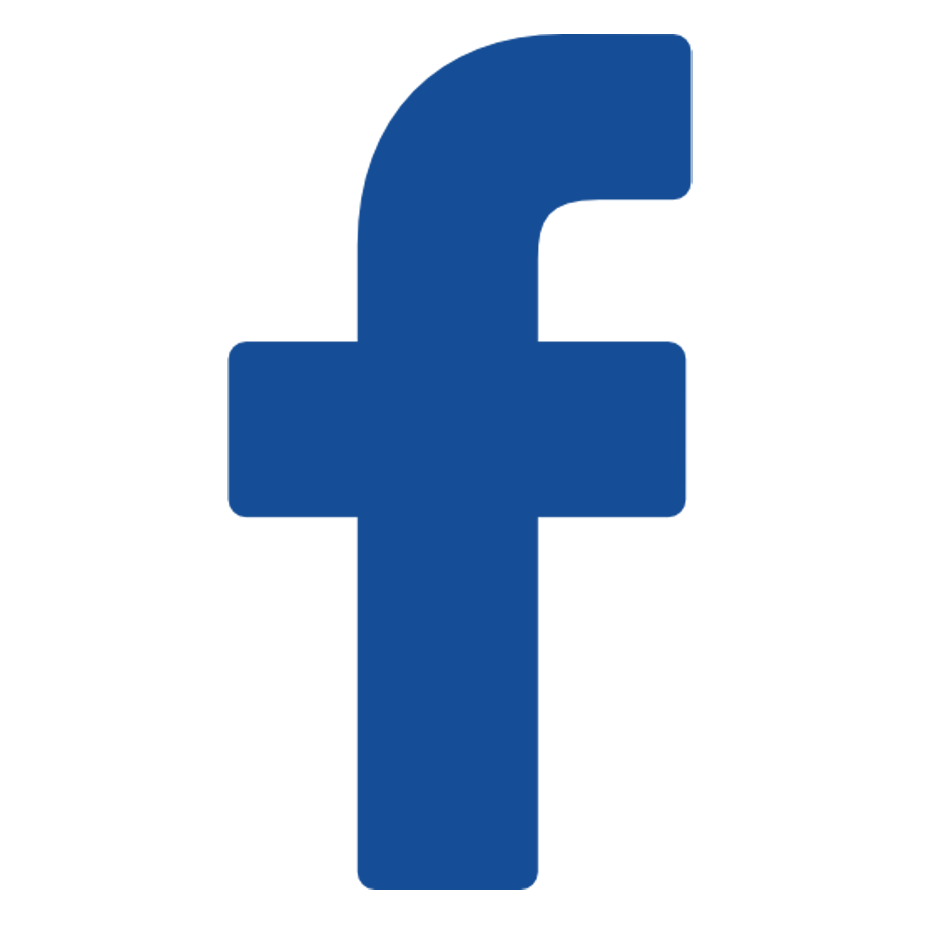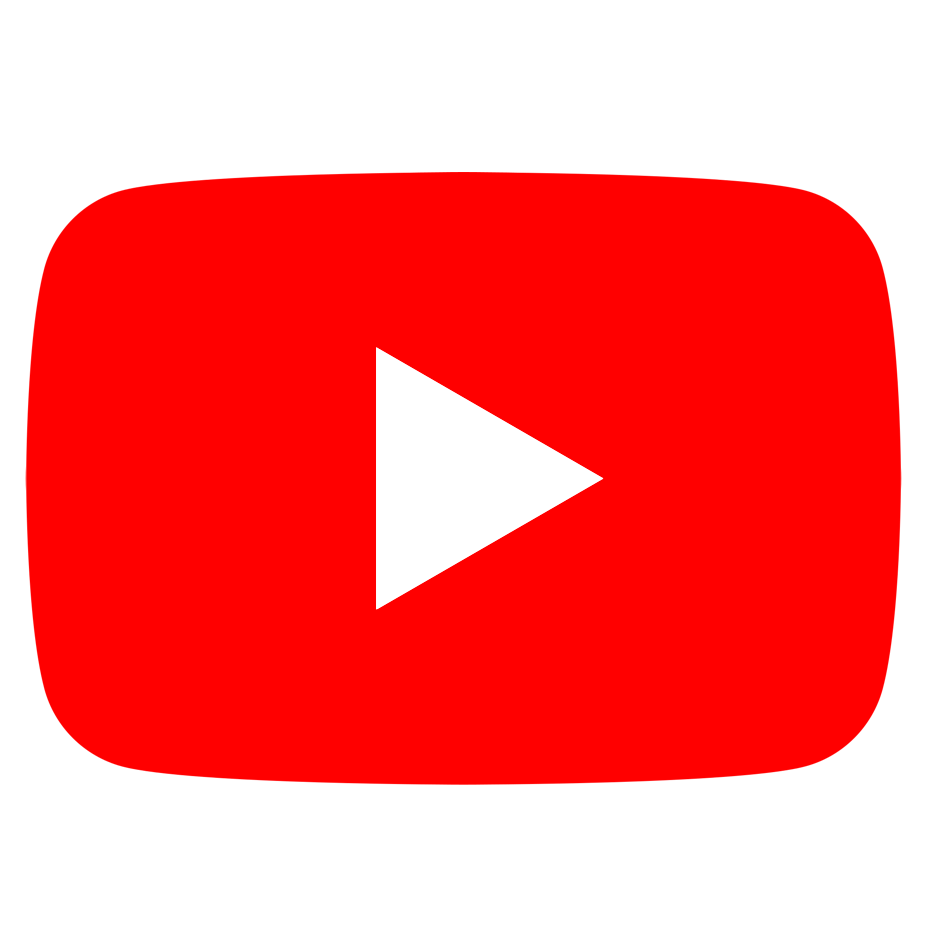Un résumé des conférences de l'édition 2025
Vous pouvez retrouver ici un résumé de chacune des conférences (rédaction P. Biscay)
Conférence Ludwig Klein
- J
- Ludwig Klein, astrophysicien, a parlé de l’activité solaire, des aurores boréales et des éclipses. Le soleil a une atmosphère beaucoup plus chaude (jusqu’à 1 000 000 K) qu’a sa surface (6000 K). Cela génère des vents solaires qui se propagent dans l’espace sous forme de particules chargées électriquement et viennent interagir avec le champ magnétique terrestre qui nous protègent. Contrairement à l’idée reçue, ce n’est pas directement l’incidence frontale avec le champ magnétique terrestre qui génère les aurores boréales. Via une reconnexion au champ terrestre, des particules solaires s’accumulent à l’arrière de la Terre. L’accumulation d’énergie se libère sous forme d’une « explosion ». Elle projette des électrons dans l’atmosphère terrestre, dans les zones polaires. C’est ce mécanisme qui génère les aurores boréales, mais par la face de la Terre opposée au soleil (« l’arrière »). La symétrie du champ terrestre fait que les aurores boréales apparaissent simultanément dans les deux hémisphères. Les deux prochaines éclipses totales de soleil auront lieu le 12 août 2026 et le 2 août 2027. La première sera visible sur une bande passant par le nord de l’Espagne (Jaca, Saragosse, ...). Elle sera presque totale à Gaillagos et Arcizans. En 2027, il faudra aller plus au sud, jusqu’en Andalousie.
Clément Baruteau
-
- Clément Baruteau, astrophysicien, a fait le point sur la détection d’exoplanètes. Le rythme des découvertes s’accélère, en particulier depuis le lancement du satellite JWT (James Webb Telescope). Plus de 6000 ont déjà été détectées, dont 30% de géantes gazeuses (type Jupiter), 5% de terrestres (rocheuses de taille équivalente), 30 % de super-Terres (rocheuses mais plus grandes) et 35% de Neptuniennes (taille de l’ordre de Neptune – Uranus). Les différentes méthodes de détection : observation directe avec un coronographe qui masque l’étoile, méthode du transit (baisse de luminosité si la planète passe devant l’étoile), méthode de la vitesse radiale par mesure spectrale (le couple étoile / planète crée un petit mouvement elliptique de rotation de l’étoile qui fait varier la distance Terre – Etoile et crée des variations régulières des raies spectrales du rayonnement émis par l’étoile. Les étoiles et les planètes se forment dans des nuages de gaz tels les nébuleuses résultant de l’explosion d’étoiles plus anciennes. La gravité tend à agréger progressivement le gaz. Ce gaz est mis en rotation, ce qui finit par créer un disque protoplanétaire. Au centre, l’étoile « s’allume » et autour des d’agrégats de plus en plus gros et plus denses qui finissent par former des planètes. L’observation de ces disques et des planètes permet de développer des modèles de formation de planètes et de leur évolution de plus en plus réalistes. Le JWT permet de mesurer les variations spectrales du rayonnement de l’étoile lorsqu’une planète munie d’une atmosphère passe devant (raies d’absorption supplémentaires). Des logiciels d’IA sont utilisés pour identifier les composants de l’atmosphère susceptibles de conduire aux variations spectrales observées. Ceci permet de détecter les atmosphères contenant de la vapeur d’eau et donc potentiellement de l’eau liquide en surface. Les chercheurs définissent une zone d’habitabilité, en référence à la Terre et au système solaire. Cette zone est exprimée dans un diagramme température étoile / insolation reçue. En juin 2025, 52 planètes sont dans la zone « habitable ». Rappel : habitable ne veut pas dire qu’il y a forcément de la vie. Ce n’est qu’une analogie avec notre planète.
Conférence Sylvie Vauclair
-
- Sylvie Vauclair, astrophysicienne, a expliqué comment se sont formés les différents atomes présents dans l’univers et dans notre planète. A l’issue du big bang et des premières centaines de milliers d’année (380 000 ans), l’univers était essentiellement constitué d’atomes d’hydrogène. Les premières étoiles, constituées de cet hydrogène, l’ont en partie consommé et transformé par fusion en éléments plus lourds situés juste après dans le tableau périodique des éléments de Mendeleiev (hélium, lithium, …) où les atomes sont rangés par masse atomique croissante. A la fin de leur existence, les étoiles suffisamment grosses ont explosé et projeté dans l’espace leur contenu sous forme de nuages de gaz (nébuleuses, …). De nouvelles étoiles ont été créés dans ces nuages de gaz. Le processus de fusion s’est alors répété, mais avec un mélange gazeux initial contenant des atomes plus lourds que pour les étoiles de première génération. Le processus s’est répété jusqu’à formation des éléments les plus lourds actuels. D’autres évènements cosmiques contribuent à ce processus, la fusion d’étoiles à neutron par exemple. Compte-tenu des propriétés physiques intrinsèques des différents atomes, il en est résulté une courbe d’abondance des différents éléments. L’hydrogène reste de loin l’élément le plus abondant, suivi de l’hélium. Le fer est abondant ainsi que plusieurs autres métaux. Mais plusieurs matériaux très importants à la transition énergétique sont malheureusement peu abondants : le cuivre, le lithium et les lanthanides (numéros atomiques entre 57 et 71) plus connus sous le vocable « terres rares ».
Conférence Alexandre Marciel
-
- Alexandre Marciel, ancien journaliste et expert sur les métaux stratégiques, a montré la complexification croissante des systèmes de production d’énergie. Un moulin à vent mobilisait typiquement 5 types d’atomes différents, une éolienne moderne plus d’une quarantaine, dont le cuivre et les lanthanides mal positionnés dans la courbe de l’abondance universelle. De façon générale, l’électrification des usages nécessaire pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre fait appel à des matériaux peu abondants et donc en tension. L’Europe n’est pas très bien placée en termes de ressources minières, ce qui rajoute un risque élevé de perte de souveraineté géopolitique. Or, tous ces produits vont connaître une explosion de la demande d’ici à 2050. La Chine, qui raisonne souvent à plus long terme que nos sociétés occidentales, analysé dès la fin des années 1990 la chaîne de valeur de la production des technologies nécessaires à la transition énergétique. Elle a identifié qu’un pays qui détiendrait le quasi-monopole du raffinage de ces matériaux stratégiques (passage du minerai « brut » au matériau « pur ») serait dominant. En moins de deux décennies, elle a capté 75% des capacités mondiales d’approvisionnement et de raffinage de ces matériaux. L’Europe n’a pris conscience de cela que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Regagner de la souveraineté stratégique tout en réduisant les émissions de GES va nécessiter une remise en question de grande ampleur.
Conférence Damien Lapierre
-
- Damien Lapierre, technicien, suivi la biodiversité locale à la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste. Créée en 2012, elle s’inscrit dans une zone Natura 2000 et comporte une Réserve Biologique Intégrale de 1000 ha sur sa partie nord dans les premiers contreforts pyrénéens. Elle est gérée par un comité syndical de 9 communes. Son intérêt réside dans la diversité de sa biodiversité (forêts, prairies, expositions très diverses du fait de la topographie) et dans la présence d’espèces endémiques dues au relief karstique et ses nombreuses cavités. La RNR a mis en place un plan de gestion visant des objectifs à long terme dans le contexte du changement climatique et un plan d’action associé. Les outils de suivi ont été pensés pour s’adapter au mieux aux caractéristiques globales de la zone et pouvoir s’appuyer sur de la science participative. Un focus sur le suivi dans les cavités a été présenté. Parmi les espèces suivies : les chiroptères et les araignées. Un exposé passionnant, au plus près du terrain et qui nous a permis de mieux comprendre l’intérêt de suivre et préserver la biodiversité qui constitue un outil majeur d’adaptation aux effets délétères que nous voyons déjà advenir du fait du changement climatique.
Film, Transition sous tension
-
- Projection du film « Transition sous tension », de l’anthropologue Violeta Ramirez. Ce film tourné aux Echassières dans l’Allier interroge les riverains et les porteurs du projet d’exploitation d’un gisement de lithium situé dans une ancienne mine de kaolin. Ce gisement pourrait fournir le lithium nécessaire aux batteries de 700 000 voitures électriques. Seules les réponses aux questions posées par Violeta Ramirez apparaissent à l’écran. Toutes les problématiques apparaissent progressivement (emploi local, faire revivre le village, pollution, intérêts particuliers et intérêt général, impact sur la forêt, ressource en eau, …) et tout le monde s’exprime en fonction de sa sensibilité (pour, contre, employés de l’entreprise exploitante, citoyens, élus). Un film très intéressant ni à charge ni à décharge mais qui pose l’essentiel des problématiques. A l’issue, une table ronde a été organisée avec des membres de l’association, deux des conférenciers et Etienne Farand du Parc National. Les échanges ont beaucoup porté sur l’opposition entre intérêts particuliers et intérêt général. Un point intéressant : malgré une assistance qu’on pouvait penser relativement homogène, les échanges ont révélé un clivage fort entre les pours et les contres. Ceci le besoin impératif d’un débat démocratique et éclairé pour décider ou pas de lancer ce type de projet minier.
Conférence Emmanuelle Porcher
-
-
- Emmanuelle Porcher, du Muséum d’Histoire Naturelle, a décrit le lien entre Agriculture, biodiversité et changement climatique. Le monde fait face actuellement à des changements majeurs dans la diversité du monde vivant (effondrement de certaines espèces et changement d’aires de répartition). Compte-tenu de la complexité du sujet et des coûts associés, la contribution des sciences participatives pour connaître les changements du vivant est essentielle. Les causes de ces changements sont tous dus à l’activité humaine : destruction des habitats, pollution, dérèglements climatiques, espèces exotiques envahissantes, surexploitation. Parmi les secteurs économiques qui les génèrent directement : agriculture, urbanisation, exploitation forestière, production d’énergie, exploitation minière, infrastructures transport, tourisme. L’agriculture : pendant des millénaires, elle a utilisé le fonctionnement du vivant (les « services écosystémiques ») et a été une source de destruction des habitats naturels (défrichage forestier), mais en même temps elle a aussi permis l’expansion d’habitats « ouverts » qui créent des habitats « nouveaux ». Certains paysages agricoles deviennent « traditionnels » dans la culture européenne, les estives par exemple. La croissance de la population humaine a conduit à émergence de l’agriculture industrielle avec : beaucoup de progrès techniques et génétiques dans les champs, un fort impact paysager par remembrement et homogénéisation, un recours sans cesse accru à des produits chimiques conçus par l’homme. Avec succès car la production mondiale agricole a été multipliée par 2 en 35 ans entre 1960 et 1995. L’agriculture industrielle qui est la principale source de disparition des espèces sauvages terrestres, avec des conséquences sur les rendements : en France rendement du cassis divisé par 4 du fait du manque de pollinisateurs. La principale : utilisation de pesticides de plus en plus toxiques, entraînant une contamination générale. Exemple : Les néonicotinoïdes, insecticides systémiques, avec des plantes contenant l’insecticide, relargage dans le sol et les plantes sauvages. Les pollinisateurs sont attirés par cet insecticide et meurent en grande quantité. Autre cause, amenée à croître dans les prochaines années : le dérèglement climatique. Il agit directement sur l’agriculture, mais en agissant également sur les espèces sauvages, il affecte les interactions entre les deux mondes et donc accroît en plus l’effet. Toutes les espèces ont une gamme limitée de conditions climatiques en température et précipitations dans lesquelles elles peuvent croître, survivre et se reproduire : la niche climatique. Par exemple, la vigne a littéralement brûlé pendant la canicule de 2019 (t° max > 47°C). Les prévisions climatiques sont utilisées pour anticiper sur le déplacement de ces niches climatiques. Le but est de prévoir des cartes des habitats favorables en fonction des espèces. Ainsi, en 2100 pour le chêne vert, son enveloppe climatique aujourd’hui cantonnée sur la côte méditerranéenne va s’étendre dans toute la moitié sud de la Loire. A l’opposé, l’enveloppe climatique du hêtre qui couvre la France sauf la côte méditerranéenne va migrer au nord de la France. Les bouleversements vont donc être considérables. A l’échelle de l’Europe, une diminution du nombre d’espèces de -25% à -62% est attendue. Les raisons : les populations peuvent se déplacer, mais pour les plantes la vitesse naturelle n’est pas suffisante. Et lorsque l’enveloppe climatique disparaît, le risque de disparition de l’espèce est très élevé car les capacités d’adaptation des espèces ne sont en général pas assez rapides. Pourquoi les sociétés humaines n’agissent pas davantage pour conserver le vivant ? Plusieurs raisons : problème extrêmement complexe nécessitant un besoin d’approches interdisciplinaires, de renforcer le lien avec la nature et de transformer collectivement le système agroalimentaire avec plusieurs objectifs : résoudre les problèmes environnementaux, améliorer les revenus et conditions de travail des agriculteurs, offrir à tous un accès à une alimentation suffisante et saine permettant de réduire les problèmes d’obésité et de diabète. Or, les subventions majoritairement l’augmentation de la production. Ces transformations sont nécessaires à cause du manque de durabilité du modèle agricole dominant en France qui a atteint ses limites, avec un usage intensif des engrais de synthèse émetteurs de gaz à effets de serre et générant des pollutions, des pesticides qui impactent la santé humaine et l’environnement et créent des résistances, l’érosion des sols, tout ceci créant une stagnation des rendements aggravée par la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques. Nous sommes face à deux options contrastées pour une agriculture plus durable : une fondée sur le progrès technologique (agriculture de précision, drones télédétection, OGM, diminution du travail humain, l’autre sur des solutions fondées sur la nature, plus résilientes vis-à-vis du changement climatique (agroécologie, amélioration des processus écologiques favorisant la production, retour de diversité spécifique et génétique, conservation de la biodiversité). En conclusion, la transition de l’agriculture nécessite des exploitations diversifiées (Polyculture-élevage), agroforesterie, avec des infrastructures agroécologiques de petite taille, avec petites parcelles, peu consommatrices en intrants de synthèse (agriculture biologique), offrant des bénéfices au-delà de la production agricole. Il est encore temps d’agir, telle fut la conclusion d’Emmanuelle Porcher
-
-
Conférence Simon Gascoin
-
- Simon Gascoin, chercheur au Centre d’études spatiales de la biosphère de Toulouse, a montré l’apport des satellites pour quantifier l’évolution récente du manteau neigeux dans les Pyrénées. Pour prendre la mesure des changements en cours, un chiffre : entre 2000 et 2023, le glacier d’Ossoue (Vignemale) a perdu 44 m d’épaisseur, soit en moyenne 2 m/an. Il aura disparu dans une quinzaine d’année. La réserve d’eau qu’il contient ne représente plus que 1% du débit d’étiage du gave à Argeles Gazost qui advient vers le mois de septembre. Il ne peut donc plus soutenir ces débits, amenés par ailleurs à baisser du fait des sécheresses estivales dues au réchauffement climatique. La disparition des glaciers pyrénéens va donc exercer un stress supplémentaire sur la disponibilité de la ressource en eau lors des périodes d’étiage. Le manteau neigeux apporte lui aussi plusieurs bénéfices : c’est un isolant thermique pour la biodiversité recouverte, une réserve d’eau et il réfléchit la lumière du soleil, ce qui retarde la survenue de sécheresses précoces. Dans tous les massifs français, on constate une baisse tendancielle de l’épaisseur du manteau neigeux. L’apport des satellites d’observation a commencé dès 1960 (1960 : 1ère image d’enneigement, 1966 : 1ère carte d’enneigement). L’évolution de ces cartes permet de mesurer l’anomalie dans l’hémisphère nord de surface enneigée au printemps (avril-juin) : 4 millions de km2 en moins entre la décennie 1970 et la décennie 2010. Actuellement, 15 satellites lancés par l’agence spatiale européenne sont en opération, 34 en développement et 7 en préparation. La distinction nuages / manteau neigeux se fait par des mesures de réflectance sur plusieurs longueurs d’ondes, ce qui permet de détecter le manteau neigeux tout en le différenciant des nuages situés au-dessus de la topographie. Des modèles d’IA par réseau de neurones sont entraînés, sur des banques de données dédiées, à cartographier automatiquement le manteau neigeux. L’évolution de cartographies permettent alors de faire lien avec le changement climatique déjà survenu et prévoir l’évolution future du manteau neigeux en fonction des différents scénarios de réchauffement. Ainsi, dans les Pyrénées, depuis 1986, le déneigement a avancé de 3 à 5 j/décennie à 1800 m d’altitude côté atlantique et encore plus vite côté méditerranée (entre 5 et 9 j/décennie). Et c’est pareil dans les Alpes. Et le réchauffement climatique s’accélère !! La fonte étant plus précoce : la crue de printemps avance, la période de végétation s’allonge et les sommets verdissent. Les satellites présentent quand même quelques limites : ils ne permettent pas de prévoir l’évolution de la masse de neige dans nos montagnes et l’avenir des écosystèmes de montagne sous l’effet du changement climatique.
Conférence Olivier Donard
-
- Olivier Donard, spécialiste de la chimie de l’environnement et membre de l’Académie des Sciences, a montré sur l’exemple de l’usine de phosphate de Gabès (Tunisie) quel pouvait être l’impact environnemental de la transition énergétique. Cette conférence de clôture est venue compléter les 2 conférences et la projection sur les matériaux stratégiques et en tension (comment se sont-ils formés dans les étoiles, quels sont-ils et quels enjeux stratégiques associés, documentaire sur un projet minier d’exploitation de lithium). Les engrais produits par cette usine représentent 4% du PIB tunisien. Pour cela, le minerai de phosphate subit une chaîne de traitement, du broyage à une purification, pour arriver sous forme d’engrais et d’acide phosphorique. Elle produit des boues résiduelles chargées de tout un tas d’éléments non valorisés. Elles sont directement rejetées dans le golfe de Gabès. Avec le temps ces rejets ont constitué une couche de plusieurs dizaines de cm d’épaisseur. Des prélèvements ont été effectués tout le long de la côte du golfe. En plus des polluants attendus (phosphates, phosphogypse et cadmium), il s’est avéré que ces sédiments sont fortement enrichis en lanthanides, matériaux stratégiques pour la transition énergétique. L’analyse des rapports isotopiques du plomb a confirmé que ces sédiments venaient bien de Tunisie et donc de l’usine de phosphate. A partir de la masse annuelle de boue rejetée (1,1 Mt/an) et du prix actuel du marché pour ces lanthanides, il a été calculé qu’ils représentent une perte financière de 50 M$/an. Cette pollution massive semble avoir des effets graves sur la santé des riveraines comme en témoigne un article du Monde de Septembre 2025. Ce cas montre qu’une règlementation environnementale contraignante est nécessaire pour limiter l’impact environnemental et sanitaire de l’exploitation minière. Olivier Donard a ensuite présenté un projet pilote de démonstrateur à taille industrielle de recyclage des matériaux des circuits imprimés porté par le BRGM. Cette technologie permettrait de récupérer beaucoup plus de matériaux différents qu’actuellement où seuls les plus chers le sont (l’or en particulier). Elle pourrait contribuer à l’Europe de retrouver un peu de souveraineté sur les matériaux où elle n’en a quasiment aucune.